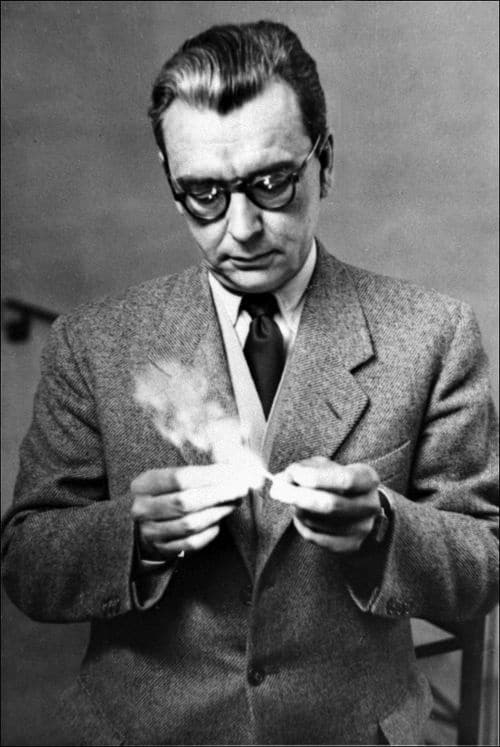
Quand je lis un livre d’Henri Calet (1904-1956), j’entends une Bossa Nova : un style élégant et sensible, un parfum de nostalgie, une touche mélancolique.
Pourtant, même s’il a vécu en Amérique Latine, c ‘est la Seine qui coule dans ses veines et c’est Paris qu’il nous conte dans “Le tout sur le tout”.
Ses souvenirs d’enfant du début du siècle (le précédent) le ramènent au ballon captif dans le ciel de la porte Maillot, aux avenues encombrées d’omnibus et de fiacres avant que ne surgissent les Phaétons ou Torpédos. Il lit “Zigomar Peau d’Anguille” et attend avec impatience d’aller déjeuner le dimanche au bouillon Chartier avec ses parents. Le bonheur absolu.
Mais Henri Calet écrit “Le tout sur le tout” entre Juin 1947 et Janvier 1948 : “en dernier lieu, il est tombé deux bombes d’un modèle neuf, minuscules mais très efficaces, quelque part du côté du Japon … Deux points à la ligne … l’Histoire s’écrit à l’encre rouge … On tourne une page, on entre dans un ère nouvelle.”
En guise d’ère nouvelle , l’après-guerre à Paris qu’il nous décrit ressemble beaucoup à l’occupation, les allemands en moins : les queues devant les magasins, les petites mesquineries, les années de privation qui s’éternisent, la grisaille partout et le froid trop souvent.
Cela n’entame pas son amour pour Paris : “En fait de ville, je ne connais rien de plus beau (…) Je regarde les dômes, les flèches, les coupoles, les tours, les cheminées d’usines, les toits, les siècles, le gris du zinc, de l’ardoise et des fumées ou des brouillards. Le gris est la teinte dominante, mais un gris nuancé, différencié à l’extrême“.
Dans ce gris “général”, Calet a plus que du vague à l’âme : “c’était un jour creux (la pluie se mit à tomber dedans)”; “encore une année qui tournait à la boue”; “la vie, en définitive, c’est vite fait et c’est bientôt dit. La vie, un petit mot d’une syllabe, presque un soupir…”
Et puis il y a cette confession qu’il dépose au détour d’un chapitre et que j’ai précieusement relevé il y a longtemps : “de trente à quarante, je me suis débarrassé de quelques inutilités; je ne crie plus, j’ai mis la sourdine; je vais plus librement. Et puis, à force de grimper, je crois que j’ai accédé à une sorte de plate-forme d’où l’on distingue un peu plus nettement les objets et les hommes, et soi-même. Ensuite, il n’y aura plus qu’à se laisser aller, doucement. Cela devrait marcher tout seul. Mais il se peut que je me trompe.”
